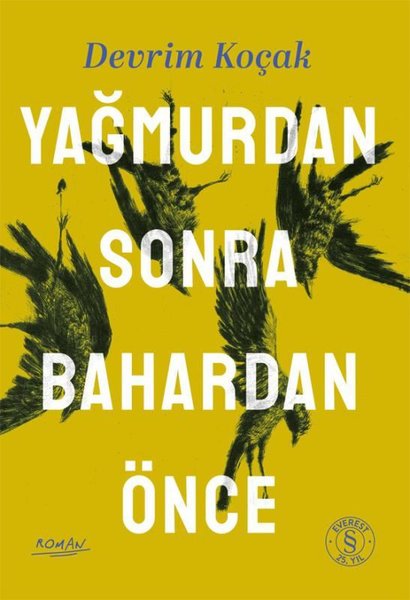Que disent les descriptions de Londres et de Paris dans le roman de Dickens, Un conte de deux villes, sur ce à quoi ressemble une société idéale ?
Deux villes, une question : quelle est la société idéale ?
Analyse philosophique de Londres et de Paris dans Un conte de deux villes de Charles Dickens
Le Conte de deux villes de Charles Dickens n’est pas seulement un récit dramatique reflétant l’atmosphère historique de la Révolution française ; C’est aussi un texte de philosophie morale et sociale. Dans cette œuvre, Dickens construit Londres et Paris non seulement comme deux villes, mais comme des incarnations de formes éthiques et politiques opposées. Dans ce contexte, les descriptions de villes dans l’œuvre nous offrent une sorte d’« ontologie négative » sur ce que n’est pas la société idéale : Dickens laisse un écho philosophique de cette question dans la carte mentale du lecteur en montrant ce que la société idéale n’est pas, et non ce qu’elle est.
I. Paris : la quête de justice se transforme en tyrannie
Paris, dans les représentations de Dickens, est le théâtre de la décadence aristocratique pré-révolutionnaire et de la violence de masse post-révolutionnaire. Paris avant la Révolution était un théâtre de despotisme féodal, où la justice était soumise aux privilèges de classe et où la lignée était privilégiée plutôt que les droits du citoyen. En ce sens, il s’agit d’un système dans lequel l’individu se soumet à l’autorité arbitraire plutôt qu’à la volonté générale, comme le critique Rousseau dans Le Contrat social.
Cependant, la principale critique de Dickens est que le mouvement révolutionnaire qui s’est développé en réponse à cette corruption a perdu sa colère légitime inhérente, laissant place à une vengeance aveugle et à la violence. Le personnage de Madame Defarge efface complètement tout sens de la justice en transformant un traumatisme personnel en colère collective. Ici, la justice ne devient pas un « nombre d’or » comme le formule Aristote dans l’Éthique à Nicomaque, mais une « justice du ressentiment » au sens de Nietzsche : la moralité des opprimés apparaît comme une force légitimant la haine refoulée.
Cette transformation à Paris est à l’opposé de la société idéale : ici il n’y a pas de nomos (loi), seulement du thymos (colère). Le contrat social n’est pas réécrit par la volonté du peuple, mais par le lynchage et la destruction de masse. Dans ce cas, on revient à l’état de nature décrit par Hobbes dans le Léviathan : un état dans lequel tout le monde est en guerre avec tout le monde.
II. Londres : une société ordonnée mais indifférente
Londres, à l’autre pôle du roman, est présentée par Dickens comme une ville relativement plus stable où règnent la loi et l’ordre. Ici, les individus sont en relative sécurité ; l’aristocratie n’a pas établi de pouvoir absolu ; L’ordre public continue de régner sans menace de révolution. Cependant, cet ordre n’a aucun visage moral. Bien que la justice existe au niveau institutionnel à Londres, un manque de sensibilité morale prévaut au niveau individuel.
Cette situation coïncide avec un point fréquemment critiqué dans les sociétés libérales : alors que les droits et libertés de l’individu sont protégés, la responsabilité éthique de l’individu envers les autres est ignorée. Selon les mots d’Emmanuel Levinas, le « visage de l’autre » devient invisible. La société désensibilise les individus à la douleur des autres en les confinant dans des espaces sûrs.
Londres est ainsi l’autre extrême de la société idéale : ordonnée mais indifférente, libre mais sans lien. Ici, le citoyen n’est ni ennemi ni ami de l’existence d’autrui ; est tout simplement hors de propos. Dans ce contexte, Londres est la ville de la neutralité morale, et non la société idéale.
III. La dialectique morale de Dickens : l’humanité entre deux extrêmes
Avec la tension qu’il crée entre ces deux villes, Dickens ne suggère à son lecteur ni un révolutionnisme pur ni un ordre stérile. Pour Dickens, la société idéale n’est ni un lieu où règne seule la justice, ni un lieu où seul l’ordre est maintenu. Le véritable idéal est une structure dans laquelle l’individu porte une responsabilité éthique envers l’autre, où la justice est rendue par la vertu plutôt que par la haine, et où l’ordre est mêlé à la sensibilité.
Le personnage de Sydney Carton est l’incarnation de cette compréhension. Sa mort peut être lue comme un salut éthique et une possibilité d’idéal social plutôt que comme une tragédie individuelle. Carton n’est ni l’un des révolutionnaires aveugles de Paris, ni l’un des citoyens indifférents de Londres. Son sacrifice est un reflet dramatique de l’idée de responsabilité infinie de Levinas et du principe de Kant selon lequel l’autre est une fin et non un moyen. En ce sens, la mort de Carton est la question silencieuse de Dickens :
« Quand la société reconnaît-elle et valorise-t-elle les individus en tant qu’êtres humains ? »
IV. Schéma philosophique de la société idéale
Un conte de deux villes ne représente pas deux villes sous la plume de Dickens, mais deux mondes éthiques distincts :
Paris est une dystopie d’une société où la justice se transforme en violence et la colère devient loi.
Londres est une critique d’une société dans laquelle l’ordre est synonyme d’indifférence et où les relations éthiques se sont estompées.
Selon Dickens, la société idéale se situe au-delà de ces deux pôles. Cela nous rappelle la définition d’Aristote du zoon politikon : l’homme n’est pas seulement un être politique mais aussi un être éthique. La société est une structure où non seulement les droits sont protégés mais aussi la valeur de l’autre est reconnue.